Permis blanc : Existe-t-il encore en 2025 ?
Aris / 28 Sep 2025 à 15h37
Temps de lecture : 4 minutes
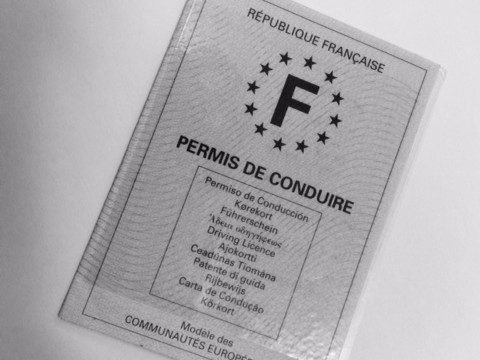
En résumé :
- Le permis blanc depuis le 1er mars 2004.
- Maintenant, il existe d’autres solutions : référé-suspension ou éthylotest anti-démarrage.
- Il vaut mieux se faire aider par un avocat expert en droit routier pour retrouver le droit de conduire.
Qu’est-ce qu’était le permis blanc ?
Le permis blanc est une expression qui résonne encore dans l’esprit de nombreux conducteurs, mais qui appartient désormais au passé. Avant sa suppression en 2004, le permis blanc était une mesure d’aménagement qui permettait à un conducteur, dont le permis de conduire avait été suspendu, de continuer à utiliser son véhicule pour des raisons strictement professionnelles. L’objectif était d’éviter que la suspension du permis n’entraîne la perte d’emploi pour les personnes dont l’activité dépendait directement de la conduite.
Concrètement, le juge pouvait accorder un permis blanc si le conducteur prouvait la nécessité de conduire pour son travail. Cela signifiait que la conduite était autorisée uniquement pendant les heures de travail et sur des trajets spécifiques liés à l’activité professionnelle. En dehors de ces créneaux, le permis restait suspendu. Il s’agissait donc d’une dérogation partielle à la suspension, visant à limiter les conséquences socio-économiques pour le conducteur.
Il est important de souligner que le permis blanc ne s’appliquait qu’aux suspensions judiciaires, c’est-à-dire celles prononcées par un juge. Il ne concernait ni les suspensions administratives (décidées par le préfet), ni les invalidations de permis pour solde de points nul (la fameuse lettre 48SI).
Comment pouvait-on obtenir un permis blanc pour aller travailler ?
L’obtention du permis blanc n’était pas automatique et était soumise à des conditions strictes. Il fallait en faire la demande auprès du juge judiciaire. Le conducteur devait alors démontrer la nécessité absolue de son permis pour l’exercice de son activité professionnelle. Cela impliquait de fournir des preuves concrètes, telles que des attestations de l’employeur, des contrats de travail, ou tout autre document justifiant que la perte du permis entraînerait une perte d’emploi ou des difficultés économiques majeures.
De plus, le permis blanc n’était pas accordé pour toutes les infractions. Certaines infractions graves, excluaient la possibilité d’obtenir un permis blanc. Le juge évaluait au cas par cas la situation du conducteur, la nature de l’infraction commise, et l’impact de la suspension sur sa vie professionnelle.
Il est important de souligner que même si le permis blanc permettait de continuer à conduire pour le travail, la durée totale de la suspension pouvait être allongée pour compenser la période de conduite autorisée. Cela signifiait que la peine, bien qu’aménagée, restait effective sur une période plus longue.
Il est important de rappeler que le permis blanc était une mesure d’exception, et non un droit acquis. Sa délivrance dépendait de l’appréciation du juge et de la capacité du conducteur à prouver la nécessité impérieuse de son permis pour son activité professionnelle.
Qui a enlevé le permis blanc ?
Le permis blanc a été supprimé par la loi du 12 juin 2003, entrée en vigueur en 2004. Cette réforme visait à renforcer la répression des infractions routières et à harmoniser les sanctions. L’idée était de mettre fin aux dérogations qui pouvaient être perçues comme une forme d’inégalité face à la loi, et d’envoyer un message plus fort en matière de sécurité routière.
La suppression du permis blanc s’inscrivait dans une politique plus globale de durcissement des mesures contre l’insécurité routière. Les pouvoirs publics ont estimé que les aménagements, même pour des raisons professionnelles, nuisaient à l’efficacité de la sanction et à la dissuasion. L’objectif était de faire en sorte que toute suspension de permis soit pleinement effective, sans exception.
Cette suppression a été motivée par une volonté de renforcer la sécurité routière et de rendre les sanctions plus uniformes. L’objectif était de garantir que toute suspension de permis soit pleinement effective, sans exception, afin d’envoyer un message clair sur la gravité des infractions routières.
Cette décision a marqué un tournant dans la législation routière française, signifiant la fin d’une ère où il était possible, sous certaines conditions, de concilier suspension de permis et activité professionnelle. Depuis lors, les conducteurs dont le permis est suspendu doivent trouver d’autres solutions pour leurs déplacements.
Qu’est-ce qui remplace aujourd’hui le permis blanc ?
Bien que le permis blanc n’existe plus, des alternatives et des aménagements ont été mis en place pour tenir compte de certaines situations. Il est essentiel de ne pas confondre ces dispositifs avec l’ancien permis blanc, car leurs conditions d’application et leurs objectifs sont différents.
Le référé-suspension
Le référé-suspension est la principale voie de recours pour les conducteurs dont le permis a été invalidé pour solde de points nul (suite à la réception d’une lettre 48SI). Il s’agit d’une procédure d’urgence devant le Tribunal Administratif qui permet de demander la suspension de la décision d’invalidation en attendant le jugement sur le fond. Pour l’obtenir, il faut démontrer l’urgence (préjudice grave et immédiat) et un doute sérieux sur la légalité de la décision d’invalidation. Si le référé-suspension est accordé, le conducteur peut retrouver le droit de conduire temporairement, sans restriction d’horaires ou de trajets.
Le référé-suspension peut également être utilisé en cas de suspension administrative à la suite d’une infraction grave au Code de la Route (excès de vitesse de plus de 40km/h, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sous stupéfiants).
L’aménagement de la suspension judiciaire
Dans certains cas de suspension judiciaire (décidée par un juge suite à une infraction), le juge peut accorder un aménagement de la peine. Cela signifie que la suspension peut être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle. Cependant, cette possibilité est strictement encadrée par la loi et n’est pas applicable pour toutes les infractions (notamment les délits graves comme l’alcoolémie ou les stupéfiants). Cet aménagement peut par exemple être appliqué en cas d’excès de vitesse supérieur ou égal à 40 km/h et inférieur à 50 km/h. C’est une décision laissée à l’appréciation du juge, qui prend en compte la situation du conducteur et la nature de l’infraction.
L’éthylotest anti-démarrage (EAD)
Pour les infractions liées à l’alcool au volant, l’installation d’un éthylotest anti-démarrage (EAD) peut être une alternative à la suspension ou à l’annulation du permis. Le juge ou le préfet peut proposerl’EAD, permettant au conducteur de continuer à conduire un véhicule équipé de ce dispositif. L’EAD empêche le démarrage du véhicule si le conducteur est positif à l’alcool. C’est une mesure qui vise à concilier sécurité routière et maintien de la mobilité.
Il est important de comprendre que l’EAD est une mesure préventive et non une dérogation à la sanction. Il s’agit d’un dispositif de sécurité qui permet de maintenir la mobilité tout en garantissant que le conducteur ne prendra pas le volant en état d’ébriété.
Il est primordial de consulter un avocat expert en droit routier pour évaluer votre situation et déterminer la meilleure stratégie à adopter. Ces dispositifs sont complexes et nécessitent une connaissance approfondie de la législation pour maximiser vos chances de succès.


